– ÉVALUATION EXTERNE DU PROJET « le droit a l’accés des enfants
Au prréscolaire : une responsabilité partagée »
Informations générales
Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour l’évaluation finale du projet « le droit à l’accès des enfants au préscolaire : une responsabilité partagée ».
1.2 Période d’exécution de la mission : 30 jours entre octobre et novembre 2022
1.3 Date limite de soumission des offres : 15/10/2022.
1.4 Responsable de l’activité: Association KRAZZA pour le développement régional (AKDER)
- Contexte
- Présentation de l’association AKDER et de l’AIDECA (en quelques lignes)
Association KRAZZA POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL (AKDER) est une association sise à la région Béni Mellal Khenifra, à but non lucratif, crée le 3 décembre 1998.
Vision :
Contribuer au développement local et régional en renforçant les capacités de la population et des Associations pour un accès facile aux services de santé, d’enseignement, d’éducation de qualité, de droit et en protection de l’environnement.
Mission :
Promouvoir l’accessibilité des femmes, des jeunes et des hommes les plus vulnérables au niveau socio économique aux services de l’éducation , de santé, de l’environnement ,de droit et de renforcement de capacités dans la région de Béni Mellal Khenifra par la mise en place des programmes de développement.
Valeurs institutionnelles :
La participation de la population cible dans la prise de décision.
La transparence dans la gestion de l’association.
La concertation avec tous les acteurs et parties prenantes.
L’association Al Intilaka pour le Développement, l’Environnement et la Culture (AIDECA) à but non lucratif a été créée en 1996, elle a accumulé d’importantes expériences et expertises dans le domaine de l’enseignement préscolaire et celui de l’accompagnement des jeunes porteurs de projets ou d’idées de projet. Parmi les réalisations de l’association AIDECA: la création d’une garderie à Afourer, le renforcement des capacités des animatrices et animateurs de l’éducation préscolaire 300 animatrices, l’ouverture d’un guichet pour les jeunes porteurs de projets ou d’idées de projets et leur accompagnement dans l’organisation d’instances formelles (coopératives, auto-entrepreneur,…), l’organisation de plusieurs séminaires sur l’autonomisation socioéconomique des jeunes en partenariat avec l’ANAPEC ainsi que des sessions de formation dans le domaine de l’insertion sociale des jeunes en situation vénérable . Enfin, l’association est le partenaire de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité qui lui a confié la gestion de son centre de renforcement des capacités des jeunes à Afourer,
- Contexte de mise en œuvre du projet
Le Maroc signataire de la convention internationale des droits de l’enfant en 1993 a franchi depuis beaucoup d’étapes dans la protection des droits des enfants. Cependant, l’accès à l’éducation pour tous les enfants âgés de 3 à 5 ans, surtout dans ses zones les plus vulnérables reste un enjeu important.
Actuellement, le Ministère de l’Éducation nationale marocain (MEN) affiche une situation où seul un enfant sur deux bénéficie d’une éducation préscolaire (49,06%), pour un effectif de 699.634 élèves dont 313.672 filles, soit moins de la moitié. Le monde rural, caractérisé par son enclavement et l’éparpillement de ses douars, reste le plus lésé avec un taux d’inscription de 35,2% dont seulement 26,9% de filles.
Vingt ans après l’avènement de la Charte Nationale d’Education et de Formation qui plaçait le préscolaire comme la première étape du système éducatif, une Lettre Royale adressée le 18 juillet 2018 lors de la Journée Nationale sur l’Enseignement Préscolaire, est venue donner une nouvelle impulsion à la dynamique de généralisation de ce secteur. La Lettre s’adresse à l’ensemble des acteurs institutionnels, publics et privés, ainsi qu’à la société civile et appelle à leur engagement auprès du MEN et de ses académies régionales (AREF) pour assurer un accès à tous les enfants du pays à une éducation préscolaire de qualité. Cependant, le chantier de la généralisation du préscolaire est très important, il nécessite en 2019 la formation d’environ 30.000 nouveaux éducateurs et auxiliaires et la création de plus de 48.000 nouvelles classes. Les effets de cette politique se sont traduit par une nette évolution du secteur. Le taux de préscolarisation dépassait au début de l’année 2022 les 71%.
Dans la grande région de Béni Mellal-Khénifra (plus de 2,5M d’habitants, 5 provinces, 119 communes rurales et 19 urbaines), l’enseignement préscolaire ne touche qu’une faible fraction de la population (49%). Les classes sont majoritairement implantées dans des structures traditionnelles, dont la plupart doivent être mise à niveau. Dans cette région, seulement 4 enfants sur 10 accèdent aux classes préscolaires (HCP) c’est-à-dire un taux de 41,1% dont 39% sont des filles. L’AREF de la région est fortement mobilisée dans le chantier de la réforme et veille à multiplier les partenariats au niveau national et international pour atteindre les objectifs de généralisation qu’elle s’est fixée à savoir un taux de 67% en 2021/2022 et de 100% en 2027/2028.
L’AKDER et son partenaire l’AIDECA, associations locales, sont des acteurs reconnus par l’AREF de Béni Mellal dans le domaine de l’enseignement du préscolaire et de la formation des éducatrices. Ce projet qui s’inscrit pleinement dans les directives gouvernementales a permis de contribuer à l’effort national de promotion de l’accès à un préscolaire de qualité, dans cette région grâce à un partenariat fort entre la société civile et les autorités locales.
- Description du projet
Le projet intitulé « Le droit d’accès au préscolaire : une responsabilité partagée » mis en œuvre par l’association AKDER en partenariat avec l’association AIDECA et l’AREF de Béni Mellal-Khenifra, avec l’appui du Gouvernement Princier de Monaco a pour objectif principal de contribuer à l’effort national de généralisation du préscolaire en améliorer l’accès à l’éducation préscolaire dans la région de Béni Mellal Khenifra.
Les axes d’intervention sont les suivants :
- La construction, et équipement d’une structure de préscolaire à TITNBLAL et l’aménagement et équipement de 27 salles dans plusieurs établissements scolaires relavant de l’AREF et d’associations locales.
- La formation de 30 éducatrices en poste et 30 éducatrices appartenant aux associations locale.
60 éducatrices seront formées et qualifiées pour l’éducation préscolaire selon les critères de formation pédagogiques définis par le MEN. (Dont 30 qui sont en fonction la première année du projet et30 nouvelles recrutées la 2ème et 3ème année du projet)
- Formation de 12 formateurs des Directions Provinciales du MEN aux approches pédagogiques spécifiques au préscolaire dans le but d’assurer l’encadrement du projet et sa pérennité.
- Organisation de 2 sessions de formation (1 session en 2021 et une en 2022) en faveur d’un groupe de formateurs provenant des cinq Directions provinciales de l’AREF de Béni Mellal – Khenifra. Cette activité est nécessaire pour assurer l’ancrage du projet au sein des Directions provinciales et de garantir la qualité du programme par la suite.
- Organisation de3 sessions de formation et de sensibilisation par an par un centre de formation qui va mettre à niveau les connaissances et compétences des éducatrices impliquées.
- La sensibilisation des familles et parents d’enfants du préscolaire et organisation de réunions systématiques avec les parents des enfants inscrits dans chaque centre préscolaire impliqué dans le projet.
- Sensibilisation de 30 associations locales à l’importance du préscolaire avec une approche droits des enfants a travers l’organisation de 2 sessions de sensibilisation.
- Création d’un réseau associatif pour le préscolaire constitué de 30 associations œuvrant dans le domaine du préscolaire dans la région de Béni Mellal-Khenifra.
- Signature de 18 conventions avec les cinq directions provinciales de L’AREF . les 18 conventions seront signées entre l’Akder et les acteurs locaux (société civile et autorités publiques) pour supporter le projet et assurer son ancrage dans la région. 3 réunions de travail ont été sur le thème du préscolaire et signatures des conventions.
- Sensibilisation des localités/communes dans la zone d’intervention du projet. Sur l’importance de préscolaire pour les enfants.
- Organisation de 2 réunions de sensibilisations pour sensibiliser les communes inclues dans le projet.
- Les 30 associations qui feront l’objet de la sensibilisation à l’importance du préscolaire sont invitées à créer un réseau régional qui va les aider à mieux collaborer et partager les expériences accumulées dans le domaine du préscolaire
- Création d’un label « Commune amie des enfants » a travers l’information des communes et ce pour valoriser les efforts des communes dans le développement du préscolaire dans leurs territoires. Nommer chaque année la commune qui mérite porter ce label
- Appuis financier aux coopératives existantes avant 2020 et ouvrantes dans le domaine du préscolaire influencées par le covid 19.
Le projet est mis en œuvre sur une durée de 36 mois, de janvier 2020 à décembre 2022.
Il vise à atteindre les objectifs et les cibles suivants :
| Objectif général | Contribuer à la promotion du droit à l’accès à l’éducation préscolaire des enfants dans les zones vulnérables de la région de Béni Mellal-Khenifra. |
| Objectifs spécifiques | Construction d’une structure de préscolaire à tit nblal .La mise à niveau et la mise en place de 25 classes préscolaires répondant à des critères de qualité selon les normes définies par le Ministère de l’Education Nationale.Equipement de 27 classes de préscolaire.Le renforcement des capacités de 60 éducatrices et des 30 associations locales.Formation de 12 formateurs des Directions Provinciales du MENSensibilisation des parents, des collectivités et des associations locales en vue de garantir l’accès des enfants en situation de vulnérabilité au droit à l’éducation préscolaireSensibilisation de 30 associations locales à l’importance du préscolaire.Création d’un réseau associatif pour le préscolaire.Sensibilisation des localités/communes dans la zone d’intervention du projet.Organisation de 2 réunions de sensibilisations pour sensibiliser les communes inclues dans le projet.Création d’un label « Commune amie des enfants ».Appuis financier aux coopératives influencées par le covid 19. |
| Résultats attendus | A la fin du projet, 1140 enfants sont inscrits et ont accès à un préscolaire de qualité.A la fin du projet, les capacités de 60 éducatrices sont renforcées.Un dispositif d’accompagnement pérenne des éducatrices et des classes préscolaires de la région de Béni Mellal est mis en placeL’accès au préscolaire des enfants en situation de vulnérabilité de la région de Béni Mellal est garanti. |
| Bénéficiaires directs | 1140 enfants ont accès au préscolaire ;12 formateurs des Directions Provinciales du MEN 60 éducatrices du préscolaire.1000 parents d’enfants.30 associations locales Communes.Coopératives impactées par COVID19. |
| Bénéficiaires indirects | 3 500 parents et 5 000 personnes issues de 100 localités concernées de la région. |
- Présentation de la mission et de la méthodologie
- Objectifs l’évaluation et critères de l’analyse
L’évaluation du projet est une étape prévue dans la mise en œuvre du projet soumis et validé par la Direction de la Coopération Internationale (DCI) de Monaco, principal bailleur du projet. Le choix d’un exercice externe a été privilégié afin de:
- Contribuer à assurer l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité du processus d’évaluation;
- Apporter une expertise sur les méthodes et techniques de la capitalisation et de l’évaluation,
- Apporter une expertise dans les secteurs concernés par le projet,
- Avoir un regard externe sur les acquis développés et proposer si nécessaire des recommandations pour l’amélioration de la qualité d’intervention de l’AKDER et de l’AIDECA.
L’évaluation vise à produire une analyse approfondie du processus de mise en œuvre du projet et de ses résultats, et de permettre aux partenaires du projet d’apprécier les 5 critères standards suivants :
- La pertinence des objectifs fixés, de l’approche et de la méthode mise en œuvre au regard du contexte.
- L’efficacité du projet, la qualité du pilotage et de la gestion du projet, et le niveau d’atteinte des résultats.
- L’efficience du projet, à savoir le rapport coût-efficacité ou le rapport entre les moyens employés et les résultats obtenus.
- L’impact du projet, à savoir les effets du projet sur les groupes cibles et le contexte, ainsi que les leçons apprises.
- La durabilité des effets du projet et l’appropriation par les parties prenantes.
De manière complémentaire et dans le but d’affiner l’analyse, l’évaluation devra tenir compte des 4 critères suivants :
- La cohérence, soit l’alignement du projet avec la stratégie générale d’intervention, les objectifs et les actions similaires et complémentaires des différents partenaires, et des autorités publiques (locales et nationales)
- La coordination du projet, soit le degré d’harmonisation de l’action avec les autres organisations qui travaillent sur la question du handicap, de l’insertion professionnelle, et le niveau de coordination entre les deux porteurs de projet (AKDER et AIDECA), soit la complémentarité, les changes de pratiques, ou encore les défis rencontrés.
- La couverture du projet, soit l’amplitude de la population touchée par le projet et capacité du projet à atteindre les populations les plus vulnérables parmi les personnes ciblées.
- La participation, c’est à dire l’analyse du niveau et de la qualité de la participation des partenaires et des parties prenantes du territoire.
L’évaluation devra fournir une appréciation générale de la qualité du travail accompli (forces, faiblesses) et des résultats obtenus par rapport aux objectifs et indicateurs objectivement vérifiables mentionnés dans le document de projet et ce en se basant sur les neufs critères ci-dessus.
L’évaluation aura pour but de mesurer (apprécier, vérifier, donner du sens, interpréter) ce qui a été fait, et de mettre en évidence les réalisations du projet. Elle devra permettre de vérifier quels objectifs ont été atteints, tant en termes de résultats qu’en termes de dynamiques et de processus impulsés.
En sus de cette appréciation, des suggestions, recommandations, des points d’attention et de vigilance spécifiques pourront être soumis à l’association pour améliorer sa stratégie globale d’intervention, au-delà de l’action évaluée.
L’évaluation devra, tout au long du processus de collecte et d’analyse, identifier les bonnes pratiques à valoriser pour une capitalisation.
- Méthodologie
Il est proposé au prestataire une méthodologie de type croisée (analyse de documents et entretiens sur le terrain), avec une forte dimension participative, permettant une appropriation des résultats par les différents partenaires et parties prenantes du projet.
Notamment, il serait intéressant que le prestataire puisse produire une grille simple d’auto-évaluation à destination du partenaire et des autres acteurs impliqués dans le cadre du projet.
Des questions évaluatives sous-jacentes aux critères sont proposées à titre indicatif à la fin du document.
- Principales étapes
A titre indicatif, les activités suivantes sont proposées pour guider le prestataire dans sa méthodologie et la construction de son chronogramme de travail:
- Recueil, étude/analyse des documents disponibles,
- Entretiens avec l’équipe du projet, au niveau de l’AKDER et de l’AIDECA, ainsi qu’avec la coordination de la DCI
- Validation des outils d’évaluation proposés par le consultant
- Entretiens et consultations avec les partenaires du projet
- Visites de terrain – collecte de données auprès des acteurs locaux
- Rencontres avec les usagers et bénéficiaires (formatrices et familles)
- Analyse des données et rédaction d’un rapport préliminaire pour l’évaluation,
- Réunion de restitution,
- Finalisation du document
Cesdifférentesphasesserontàpréciserdanslapropositiontechniqueduconsultant.
- Documentation
Le prestataire s’appuiera notamment sur les documents ressources suivants:
- Documents de projet (narratif, cadre logique, budget);
- PV disponibles de réunions pertinentes pour l’évaluation;
- Termes de référence et documents clé développés au fil du projet;
- Rapports narratifs et financiers intermédiaires;
- Rapports des équipes AKDER et AIDECA
- Publications produites dans le cadre du projet,
- Etc.
- Rôles et Responsabilités
En tant que porteur du projet principal, l’AKDER est responsable des tâches suivantes pour la bonne mise en œuvre de la mission :
- Mettre à la disposition du prestataire la documentation du projet, les listes de contacts des partenaires et parties prenantes, y compris les bénéficiaires, et tout document pouvant aider à comprendre le projet
- Organiser et coordonner les réunions de cadrage et de restitution avec le prestataire et les partenaires
- Faciliter la prise de contact avec les parties prenantes en envoyant un email d’information au démarrage de la mission. Au besoin, durant la mise en œuvre de la mission, remobiliser les parties prenantes.
- Si besoin, apporter une assistance pour la logistique (organisation de dates, visites de terrain, etc.)
- S’assurer du bon suivi du processus de lecture et de validation des documents et rapports tout le long de la mission entre les partenaires, l’équipe projet et le prestataire.
Responsabilité du prestataire en charge de l’évaluation
- Présenter une méthodologie et un calendrier cohérent avec la mission
- Elaborer et partager avant chaque réunion, une présentation power point reprenant les éléments relatifs à l’état d’avancement de la mission.
- Prendre part aux réunions de cadrage et de restitution
- Elaborer les outils de la mission (guides et questionnaires, liste des personnes à consulter à jour, calendrier de travail à jour, etc.)
- Assurer la logistique relative aux visites de terrain (si besoin demander l’assistance d’AKDER et AIDECA, mais le prestataire est autonome dans l’organisation des missions)
- Elaborer le rapport d’évaluation préliminaire et final
- Restituer selon le calendrier convenu avec l’équipe de projet les livrables attendus.
- Calendrier de la mission
Le total-jour sera de 30 (trente) jours, à affiner en fonction des propositions.
Le prestataire devra démarrer le 20 octobre 2022.
La proposition devra proposer un calendrier détaillé du déroulé des différentes étapes de la mission.
- Produits et livrables attendus
- Une réunion de cadrage avec AKDER, AIDECA et la DCI durant laquelle la méthodologie, la démarche et le calendrier de travail proposés par le prestataire seront discutés, précisés et validés
- Suite à cette réunion, une note de cadrage actualisée suite à la réunion de cadrage. Cette note devra inclure en annexe
- un calendrier détaillé, les questions évaluatives, et les outils de l’enquête, à savoir la liste des documents, la listes des personnes à interviewer, les guides d’entretiens et démarche de focus group s’il y a lieu, etc.
- Une réunion de restitution avec l’équipe du projet à l’issue de la mission de terrain. A cette occasion, un point sera fait sur le déroulement de la mission, ainsi que sur les premiers résultats et recommandations qui seront discutés.
- Suite à cette réunion, un 1er rapport de l’évaluation finale du projet sera élaboré et présenté à l’équipe projet
- Une réunion de restitution de l’évaluation finale sera tenue à la fin de la mission. Le prestataire devra présenter les conclusions et les recommandations de l’évaluation devant l’équipe de projet, la DCI et les partenaires du projet invités par l’AKDER et AIDECA. Cette restitution sera organisée en ligne.
- Suite à la validation du premier rapport et tenant compte des différentes remarques durant la réunion de restitution, le rapport final de l’évaluation devra être remis à l’AKDER, AIDECA et la DCI.
Rédigé en langue française, il comprendra un résumé exécutif, ainsi qu’une description détaillée de la méthodologie utilisée, des observations, des conclusions et des recommandations.
NB : Tous les documents (provisoires et finaux) seront des propriétés exclusives de l’AKDER, AIDECA et de la DCI de Monaco. Toute communication ou publication liée aux documents objet de la présente mission devra faire l’objet d’un accord préalable avec AKDER, AIDECA et la DCI de Monaco, chacun pour ce qui le concerne.
- Expertise recherchée
La mission d’évaluation sera menée par un consultant présentant les compétences et expériences suivantes, dûment référencées :
- Connaissance des domaines de l’éducation, du préscolaire et de l’enfance au Maroc,
- Connaissance des attributions des acteurs intervenant dans ces domaines
- Connaissance des dynamiques entreprises au niveau national,
- Une expérience prouvée dans l’évaluation des projets et la capitalisation sur les bonnes pratiques
NB : Les langues parlées sont l’arabe et le français.
- Soumission
Les consultants et cabinets d´études intéressés par cette évaluation font des propositions techniques qui seront analysées par un comité de sélection mis en place à cet effet.
Les offres techniques seront envoyées par courrier électronique au plus tard, le 15/10/2022 un délai de rigueur, à l´adresse électronique : monacomarocprojet @gmail.com
en mettant en copie les deux mails de la DCI :
-Zoubida Mseffer : zmseffer@gouvernement.mc
-Elodie Martin: emartin@gouv.mc
L’offre technique doit contenir les éléments suivants :
- La compréhension des TDRs
- Une proposition de méthodologie claire et détaillée de conduite de l’évaluation ;
- Une proposition de calendrier de travail à valider de commun accord
- Les CV des consultant(e)s chargé(e)s de la conduite de l’évaluation.
Annexe
Principales questions et critères d’évaluation à mobiliser
A titre d’exemple, et sans prétendre être exhaustifs, quelques questions guides sur les attentes de l’évaluation sont proposées dans la liste suivante, par critère:
Sur les critères Cohérence, pertinence efficacité et efficience, s’appuyer essentiellement sur la documentation du projet (document de projet, rapports narratifs annuels, compte-rendu et rapports de suivi, produits). L’évaluation doit se focaliser sur les aspects relatifs aux impacts et aux changements induits par le projet. Une attention particulière doit être mise sur les critères d’impact et les effets ; la couverture du projet et la participation.
Cohérence
- Le projet est-il en conformité avec la politique nationale … ?
- La stratégie d’intervention a-t-elle été cohérente avec d’autres actions similaires mises en œuvre dans la zone d’intervention du projet ?
- Quelles est la valeur ajoutée des initiatives appuyées par le projet en comparaison avec d’autres initiatives menées en parallèle sur le même territoire et/ou la même thématique par d’autres intervenants ?
- Le projet est-il en ligne avec les priorités établies par les autorités locales, régionales ou nationales dans le domaine?
Pertinence
- Dans le contexte national de généralisation, le projet a-t-il bénéficié de dispositions et d’apports complémentaires qui ont renforcé son action ?
- Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins et priorités des groupes cibles ?
- Les approches recherche/sensibilisation/formation/plaidoyer déployées ont-elles été pertinentes ?
- Les actions menées ont-elles été en adéquation avec les capacités des acteurs locaux ?
- Les activités ont-elles été menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs nationaux et locaux, et le choix de ces collaborations a-t-il été pertinent ?
- Est-ce que la construction des classes est en cohérence avec le cahier des charges du ministère ou s’est-elle adaptée aux moyens et contraintes locaux ? les espaces de jeux extérieurs sont-ils équipés et opérationnels ? les sanitaires sont-ils opérationnels et adéquats pour les exigences de la petite enfance ?
- Le matériel pédagogique utilisé est-il accessible ? (Facilité de disposer des manuels, facilité de compréhension des activités proposées, facilité de reproduire les matériels, facilité d’utiliser la langue arabe ou le français, etc )
Efficacité
- Les résultats obtenus sont-ils conformes aux résultats attendus initialement ?
- Dans quelle mesure les objectifs spécifiques ont-t-ils été atteints au regard des indicateurs définis ?
- Dans quelles mesures les partenaires et les autres acteurs directs sont-ils satisfaits des résultats du projet ?
- En particulier, des changements ont-ils pu être observés au niveau de la première année du primaire des groupe d’enfants préscolarisés ? des informations existent-elles à ce sujet ? des liens avec l’école primaire ont-ils été établis ?
- Le projet a-t-il créé une cohésion, une dynamique de concertation et de coopération entre les acteurs ?
- Les actions de sensibilisation, formation et plaidoyer ont-elles permis d’apporter les résultats escomptés ?
- Comment les obstacles rencontrés ont-ils été dépassés / contournés ? Certaines activités ont-elles été renforcées (ou au contraire réduites, réorientées) ? Si oui, quelles en ont été les principales causes et quels ont été les principaux résultats ?
Efficience
- Les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers) par rapport aux objectifs atteints ont-ils été adaptés par rapport aux activités du projet?
- Des retards dans la mise en œuvre des activités ont-ils eu lieu ? Si oui, quelle influence cela a-t-il eu sur la conduite et le déroulement du projet ?
- Les dispositifs de suivi, d’accompagnement et d’évaluation en interne ont-ils été réalisés tel que prévu dans le document de projet ?
- La stratégie et les modalités de partenariat développées sont-elles en cohérence avec les résultats et les objectifs attendus du projet ?
- …/….
Effets et Impact
- Quels sont les effets du projet (positifs et négatifs) ressentis par les bénéficiaires directs et indirects, les partenaires ? Comment les ressentent t-ils ? Les changements sont-ils durables ?
- Quel progrès apporté par le projet en termes de renforcement des capacités ? En particulier, quels effets observés sur l’amélioration de la qualité du préscolaire dans la région d’intervention ?
- Le projet a-t-il eu des effets et impacts différents en fonction des groupes cibles? par exemple :
- Est-ce l’accès au préscolaire, dans certains cas, a-t-il induit des changements notables dans la vie des familles, des mères, des communautés ? lesquels ?
- Est-ce que cette dynamique a eu un impact positif sur l’accès des jeunes femmes de la région à la formation et à l’emploi dans le secteur de la petite enfance
- Est-ce que la communauté éducative dans les écoles a bénéficié de ce projet
- Est-ce que d’autres associations/institutions/services s’engagent dans le champ du préscolaire en s’inspirant des méthodes développées par le projet ?
- Quelles sont les mesures à prendre pour renforcer / garantir cet impact sur le long terme ?
- …/…
Couverture
- Le projet a-t-il réussi à atteindre les groupes cibles prévus ?
- Quel est le nombre d’enfants non préscolarisés dans la région au moment de l’évaluation ? quelles actions mises en place par l’AREF pour les intégrer ?
- Quel ratio d’éducateur par enfant dans les classes du projet ?
- Quels défis pour la mise à disposition d’éducatrices/eurs qualifiés ?
- …/…
Participation
- Quelles stratégies et instances prévues pour assurer une participation active des partenaires et des parties prenantes (dont les familles, responsables de l’éducation, y compris les directrices et directeurs d’établissement, les éducatrices, communautés locales, les instances locales, etc.) Tout le long du cycle de projet ont été mises en œuvre ?
- Les stratégies ont – elles été efficaces ?
- Est-ce que le genre a été pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre des activités et comment ?
- …/…









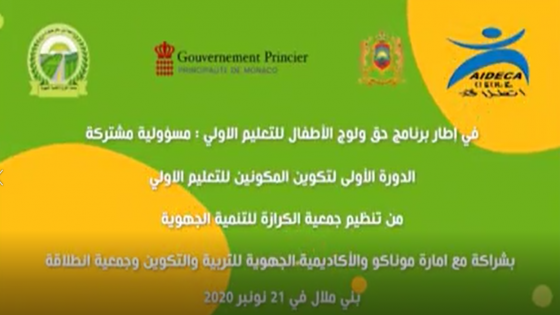
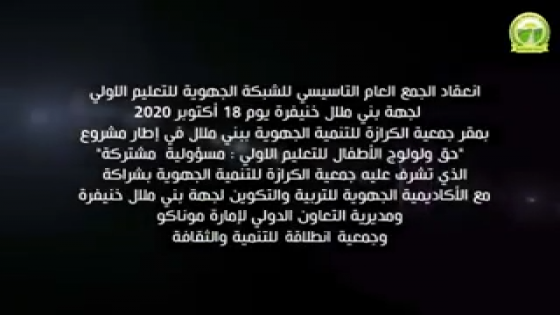
Sorry Comments are closed